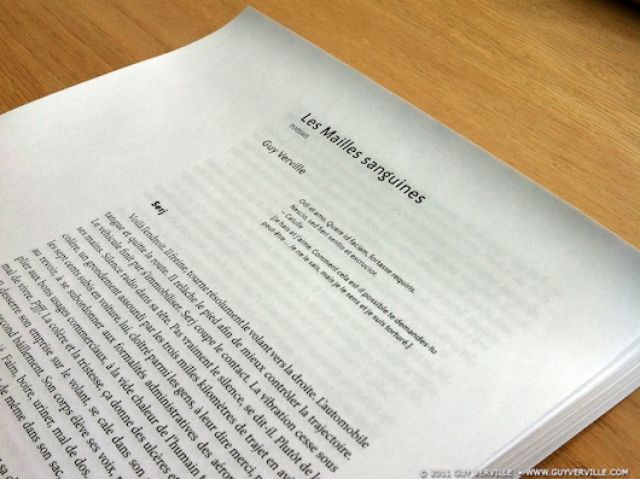Trac et impatience
La fin de l’écriture du roman ne m’a certes pas calmé, plutôt le contraire. Le sentiment du devoir accompli s’est vite mu en trac mélangé à de l’impatience, sans oublier le doute et l’inévitable bouillonnement des comparaisons et des jalousies.
Il suffit de rôder autour des Éditions du Boréal, des Éditions Alto, Héliotrope, pour n’en nommer que trois parmi les bons éditeurs; il suffit de craindre qu’ils refusent mon manuscrit pour que l’orgueil, encore une fois, en prenne un coup. Il suffit de lire les critiques élogieuses sur tel ou telle auteur(e), de les comparer à mes écrits...
Quelqu’un me disait, il y a deux jours, quand je lui ai annoncé que j’avais terminé mon roman: «quoi, ça se termine, un roman?». J’ai trouvé la bravade on ne peut plus insensible et elle alla droit au coeur. Bien entendu, un texte ne sera jamais achevé, on peut le réécrire sans cesse. Cependant, il faut bien mettre le point final, passer à autre chose. Et cet acte enclenche les autres machines, celle du désir d’être entendu, celle aussi inventée par le fou du roi qui nargue déjà toutes nos prétentions.
C’est fort, l’orgueil. Pourtant, quand je révisais mon roman, rien ne résistait à mon jugement. Des chapitres entiers sont passés sous la hache. Maintenant qu’il faut laisser le regard et l’esprit des autres fendre la peau de mes sensibles balivernes, je deviens paternel, maternellement étouffant.
Je ne suis pas un littéraire dans le sens que je ne fréquente ni les salons ni les librairies. Mon esprit est ailleurs et mon corps combat, s’enivre du bon miel des gens, mon coeur bat toutes les chamades. Il est donc fort à parier que la critique sera sévère.
À ce stade, on peut me dire de cesser de me plaindre, et on aura bien raison. C’est que je ne me plains pas. Je ne fais que compter nerveusement le temps.