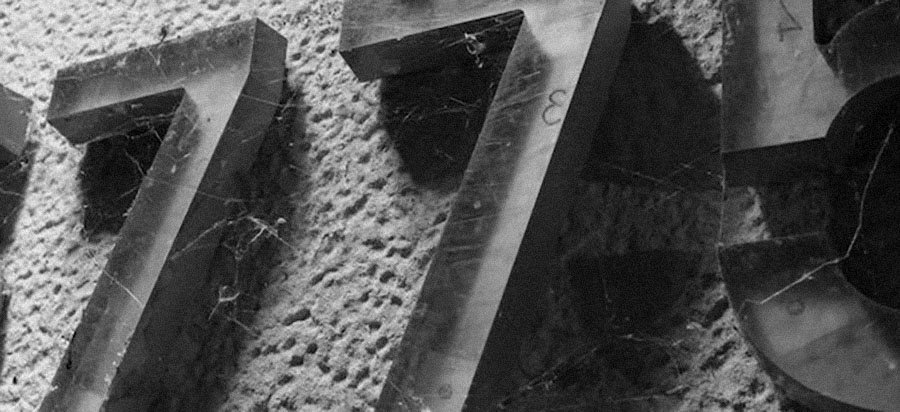
Du temps qu’il nous reste
Ai terminé la lecture de [Illness](http://www.amazon.ca/Illness-Havi-Carel/dp/1844651525/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1354713260&sr=1-1), de Havi Carel. J’avais entendu cette femme dans un reportage sur une maladie orpheline des plus rares. Jeune professeure de philosophie, elle se croyait en parfaite santé, maître de ses moyens, était sportive, s’alimentait bien. Et, soudain, elle s’essouffla. De première de course, elle se retrouva souvent à l’arrière, asphyxiée par l’effort. Le diagnostic ne se fit pas attendre: [Lymphangioléiomyomatose](http://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphangiol%C3%A9iomyomatose) (ou LAM), qui se caractéristique par un étouffement graduel des poumons par des kystes mystérieux. Traitement connu : aucun. Chance de survie : trois, cinq, dix ans...
Le livre reprend au début, presque mot pour mot, comme si elle avait relaté ou revécu *ad nauseam* cet épisode de sa vie, ses réactions de peur, d’angoisse, et de stupéfaction devant le constat. En très peu de temps, elle fut affublée d’une bouteille d’oxygène. De personne « vivante », elle est devenue un « être en sursis ».
L’originalité, si je puis dire, de ce livre, est qu’il est écrit par une philosophe habituée aux « discours » sur l’existence. Pourquoi vit-on, pourquoi meurt-on, quelle est la bonne manière de vivre ? Ces questions gravitant autour de la quête de sens ont été vite confrontées, chez Carel, à la réalité brutale d’une maladie dégénérative. S’ensuit, au fil des pages, une description phénoménologique de la maladie, une réflexion sur notre attitude face à notre corps. L’auteure nous parle de Merleau-Ponty, de Descartes, Heidegger, Hegel, Nietszche et, enfin, d’Épicure.
Plusieurs se reconnaîtront dans cette première partie de l’ouvrage, tant ceux et celles qui se sont vite vus privés de leurs capacités physiques (par le handicap ou la maladie) que ceux et celles qui vieillissent lentement. Notre corps est notre vaisseau. Par lui, notre existence se meut dans un univers de possibles, dans la réalité, se projetant dans un futur toujours prometteur. Quand tout va bien, notre esprit gambade, s’angoisse comme un adolescent, se tord de douleurs pour des difficultés qu’il arrive pourtant à surmonter. Mais lorsque le corps n’y est plus, des murs opacifient rapidement l’horizon et c’est le choc. Le vrai problème demeure la mort...
Havi Carel, comme des milliers de personnes atteintes d’une maladie incurable, a dû rapidement faire le deuil de son existence. Son esprit articulé et intelligent a fait le reste. Il l’a accompagnée dans une refactorisation de son existence, et c’est ce qu’elle cherche à décrire dans la deuxième partie du livre qui pourrait paraître à la première lecture moins originale. Qu’est-ce que la maladie ? Qu’implique-t-elle ? Pourquoi le corps médical est si peu préparé à traiter de la personne malade autrement que par diagnostics répétés, l’attitude des gens dits normaux (fonctionnels) face aux maladies, la nécessité, pour la personne atteinte, de changer d’horizon existentiel et de finir par y trouver une nouvelle manière de vivre le bonheur.
Cela nous conduit à la troisième partie axée sur la finalité, la mort. Qu’est-ce que le bonheur de vivre, qu’est-ce que la mort ? Comment peut-on dépasser la crainte de la mort ? En quoi origine justement cette crainte ? C’est à ce moment que la lecture devient très zen. Les conclusions de l’auteure rejoignent rapidement ce qui a été dit par Épicure (qu’elle cite beaucoup) : la mort ne nous appartient pas. Quand nous sommes morts, nous ne sommes pas. Quand nous sommes vivants, nous ne sommes pas la mort. Le passé n’est que réinterprétation, le futur que fabulation, le présent, paradoxalement évanescent, est notre seule certitude et notre seule emprise sur la réalité. Bouddha et ça, c’est la même chose.
La qualité du bonheur ne se mesure pas non plus en quantité. Quand on est jeune, on pense que le bonheur viendra, puisque le paysage du futur est si large. Tous ceux qui sont arrivés au-delà des deux tiers de leur vie savent que ces vallées, longtemps très larges, se sont creusées. L’eau coule, vieillotte, au fond de ravins plus étroits. Il semble n’y avoir plus qu’un passage méandreux, parfois silencieux. Lorsqu’on est frappé par un diagnostic comme la LAM, on voit se transformer à vue d’œil les contrées des possibilités. Une personne qui meurt subitement ne voit rien, ne vit en rien la tragédie de l’abandon de l’existence.
En conclusion, ce livre est beau, simple. L’auteure se répète peut-être un peu trop souvent, car, au final, elle n’a peut-être pas grand-chose à dire. Tout aurait été dit, n’est-ce pas, à ce sujet. Force est de constater que, malgré cet entendement, personne n’écoute. Le mérite de cet ouvrage est donc de ramener le sujet sur la table et de le confronter à notre modernité. Un livre à lire et qui donne le goût d’aller voir du côté du sage et sobre Épicure ce qu’il avait, justement à enseigner, il y a de cela si longtemps.
Nous n’avons, depuis, rien appris ?

